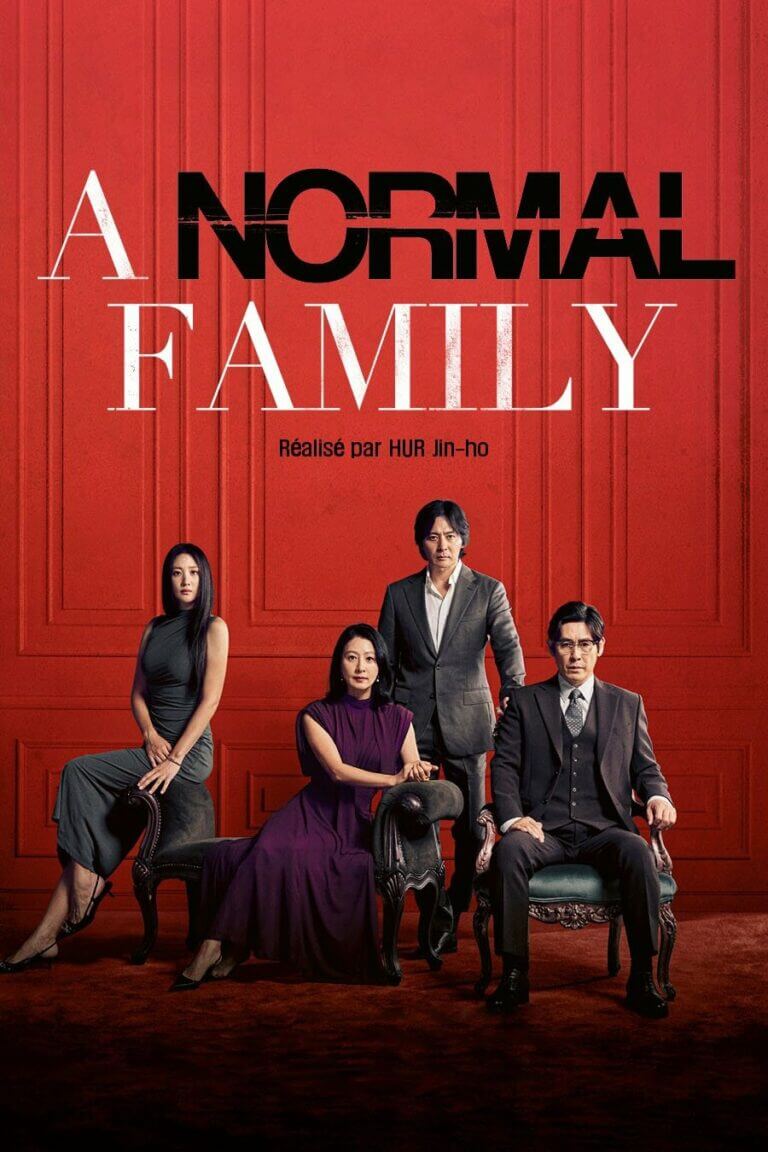France
Scénariste, réalisatrice
Jeune femme (Caméra d’or au festival de Cannes 2017, sélection « Un Certain Regard »)
Entretien avec Léonor Serraille
« Jeune femme » aurait pu s’appeler « Jeunes femmes » : dans l’équipe, les femmes sont à tous les postes: directrice de la photographie, ingénieure du son, monteuse image, monteuse son, décoratrice, compositrice, productrice…
Pour tourner Body, mon moyen métrage, j’avais fait appel en grande partie à mes camarades de la Fémis, et comme j’avais apprécié leur travail et l’énergie qui nous réunissait, nous avons continué ensemble. Ce n’était pas un choix délibéré de faire un « casting d’équipe » féminin, mais à l’arrivée, je ressens une grande fierté : il est important que des femmes arrivent massivement à des postes décisifs.
Cette particularité nous a énormément apporté sur le tournage. Pour beaucoup d’entre nous, c’était notre premier long métrage, nous étions très enthousiastes, très investies, devant un enjeu qui était presque un peu trop fort pour nous. Nous avons travaillé avec une grande liberté, y compris dans la mise en scène : je partais plutôt de plans séquences (prolongements naturels de l’écriture pour moi), mais ensuite avec la monteuse nous avons parfois abouti à une tout autre forme, plus cut (comme pour l’entretien d’embauche) : j’ai essayé à chaque étape que tout le monde se sente libre de proposer, de tester. Le rythme de tournage, très intense, nous imposait en permanence de trouver des solutions, de rebondir. Cette façon de travailler était bouillonnante mais libératrice. Le tournage a ressemblé au personnage : il était vivant. Le stagiaire de production ou le machino pouvait tout à coup interpréter un rôle de façon imprévue, et c’était réjouissant, inattendu, moteur.
Cette liberté peut parfois faire penser que certaines séquences relèvent de l’improvisation…
Alors que c’est au contraire un scénario très touffu, détaillé. A l’origine il faisait 140 pages, et comme il fallait éviter l’écueil de la chronique, en réécriture et au montage, on a toujours plus recentré le récit autour de Paula. Je prends beaucoup de plaisir à l’étape de l’écriture, j’ai fait des études littéraires, et je pensais au départ écrire des livres. C’est en séchant les cours et en allant au cinéma assidûment, et en particulier en voyant Shara de Naomi Kawase (2003) ou The Taste of Tea de Katsuhito Ishii, que je me suis dit qu’il y avait autre chose que les lettres… Mais je conserve un très grand plaisir à écrire les dialogues. Mettre en scène une femme dans la ville ne me suffisait pas, il me fallait inventer un langage à cette personne au début insaisissable mais courageuse. Je voulais aussi faire honneur aux gens qui parlent, qui « l’ouvrent ». Il y a peu d’improvisation, seulement quand certaines scènes l’imposent – je pense aux séquences avec Lila, la petite fille, où le texte est secondaire, et où il faut avant tout saisir un courant fragile, ténu entre Paula et l’enfant ; ou quand une dispute éclate, pour faire « monter la mayonnaise » entre deux personnages. Bien sûr, les actrices et les techniciennes ont aussi fait des propositions, qui m’ont fait sans cesse adapter mon scénario et réécrire mes dialogues ; par exemple Laetitia Dosch a inventé la coiffure originale que Paula trouve chez l’épicier pour dissimuler sa cicatrice au front ! Mais en général j’ai senti que Laetitia était en demande d’un travail à partir d’un texte précis.
Le film s’ouvre pourtant davantage sur des coups et des grognements que sur un dialogue proprement dit…
Au début, Paula nous agresse, et c’est un défi d’écriture que de construire ce qu’il peut y avoir d’attachant à partir de cette agressivité. J’ai pensé sa trajectoire comme une progression de l’animal à la personne ; elle part d’un manque de contrôle presque bestial, d’une logorrhée, pour atteindre une conscience de soi, une solidité. Au montage, nous avons trouvé un parallèle entre le premier plan de dos, sombre, vitupérant, et le tout dernier plan. Mais l’important, c’est la porosité de Paula, la façon dont elle s’imprègne des rencontres. Elle change comme un caméléon, quitte à essayer des identités, comme quand, dans le métro, Yuki croit reconnaître en elle une amie d’enfance, ou qu’elle se fait passer pour une étudiante en arts plastiques pour se faire engager comme baby-sitter. Même dans ce costume qui n’est pas le sien, elle creuse, elle avance. J’ai voulu que le spectateur puisse être actif dans cette transformation : les ellipses ont été cruciales à toutes les étapes de la fabrication du film. Le personnage surprend, trouve des cheminements inattendus, et parfois, ses comportements les plus exubérants sont ceux qui passent le mieux – j’ai moi-même pu le constater en surjouant à des entretiens d’embauche !
Pensiez-vous à Laetitia Dosch au moment d’écrire Jeune femme ?
Non, je n’avais aucune actrice en tête. En la voyant dans La Bataille de Solferino de Justine Triet (2013) et dans des vidéos de ses spectacles sur internet, j’ai eu envie de la rencontrer. Il y avait aussi des résonnances évidentes entre elle et Paula. Mais c’est cette rencontre, dans la vraie vie, donc sa personnalité, qui m’a déterminée à modifier l’écriture du personnage. Déjà en la « googlelisant» j’avais été frappée par les contrastes entre des photos hyper glamour et d’autres pas du tout, ce qui m’avait fait penser au visage si changeant d’Anna Thomson dans « Sue perdue dans Manhattan » d’Amos Kollek (1997). Je cherchais justement une comédienne qui puisse jouer toutes les couleurs du personnage mais également qui puisse contredire ce qui était écrit. Lætitia a une nature indéfinie, à la fois cash, joyeuse, vivante, mais j’ai aussi vu en elle une tristesse, qui correspond au côté brisé de Paula. Sa fantaisie est un donné, mais l’autre pôle pouvait émerger, il fallait travailler cette matière plus sombre. Elle me fait penser à Patrick Dewaere et Gena Rowlands, elle possède la même capacité à être transportée d’un état à un autre, d’une énergie brute à une douceur mélancolique, et cela m’émeut. Laetitia est comme un instrument à mille cordes, elle peut être aussi femme fatale, ou au contraire glaciale, adolescente, petite fille. Elle a des « températures » déstabilisantes. Dans le spectacle de Lætitia, un one woman show intitulé Un Album, elle interprète tour à tour quatre-vingt personnages. Chez Paula, il y a un côté « performeuse » au sens artistique, peut-être parce que quand on n’a plus rien, le moindre acte est un dépassement de soi, une performance.
Cette identité toujours en mouvement vous a-t-elle imposé une forme ?
La multiplicité du personnage passait notamment par un travail sur le grain. J’avais jusqu’à présent uniquement filmé en pellicule 16 millimètres ; ma chef-opératrice a collaboré en amont avec l’étalonneur pour trouver la bonne combinaison optiques/ grain avec la camera numérique car elle savait que j’appréhendais ce passage. A toutes les étapes, elle a travaillé sur les teintes, froides et chaudes entre lesquelles Paula est un peu écartelée. Il fallait que l’image ressemble à ce qu’elle vit,et que le montage respire comme elle, fasse corps avec elle, qu’elle puisse dire ou vivre des choses très crues mais glisser dans des décors chaleureux, sensuels, qui sont comme des bains révélateurs de ses visages. Il fallait vibrer comme elle, sans règle ni concept. C’était Paula, le concept.
Il y a pourtant une violence à la grande plasticité du personnage: pour obtenir une place de vendeuse au « Bar à culottes » du centre commercial, elle se laisse relooker, remaquiller…
Oui, c’est à double tranchant : la fragmentation de cette vie urbaine blesse. Il faut adopter des codes, des façons de parler, et mine de rien, travailler toute une journée à vendre des soutien-gorge, ça joue sur nous, ça déteint. Je l’ai vécu. Mais il ne s’agissait pas pour moi de faire un film autobiographique. Avec Paula, j’avais besoin de revivre cela avec quelqu’un qui rentrerait dans le lard des gens, qui trouverait du plaisir à cette errance. Je suis aussi sensible au fait qu’en tant que femmes, le territoire de la ville ne nous appartient pas de la même façon qu’aux hommes ; il y a peu de courageuses pour y circuler complètement librement, habillées comme elles le veulent, roulant des mécaniques. Paula est un peu un modèle, en ce sens là…
Il y a des similarités entre cette contrainte qui pèse sur Paula et toutes les femmes, et la façon dont elle-même aborde Ousmane, le vigile noir du centre commercial qui est surdiplômé…
Mon compagnon est noir et il a toujours l’impression qu’on va lui demander ses papiers, qu’il a fait quelque chose de mal… J’avais envie que la question soit dans le film mais en filigrane. Il y a même un soupçon de racisme de la part de Paula quand elle aborde Ousmane pour la première fois en critiquant son costume : elle n’a plus rien, mais elle se croit quand même supérieure à lui. Il doit lui demander le respect.
L’errance de Paula passe par une traversée d’espaces, une multiplicité de décors socialement contrastés, de l’appartement cossu de Joachim à la maison en banlieue de la mère, la chambre de bonne ou l’appartement d’Ousmane à Aubervilliers.
Il y a aussi un décor intermédiaire, le métro, qui est l’espace du hasard, du possible, comme la rencontre avec Yuki, celle avec le jeune homme à cravate, ou encore le moment d’errance où on entend un morceau qui me tenait très à cœur et préexistait au film, Las Vegas Tango de Gil Evans. J’ai écrit le scénario en ayant beaucoup écouté ce morceau de jazz qui passe par une phase dépressive, puis où l’énergie revient, avant un finale d’une grande intensité ; c’était un rêve d’en obtenir les droits pour le film. La musique cherche à épouser le « voyage » dans la ville. Grâce à Paula, chaque rencontre a quelque chose d’un peu magique. On peut les appréhender comme des perles, très différentes, s’enfilant sur un fil, et formant un collier plein de contrastes. Ces rencontres jalonnent la ballade initiatique de la jeune femme avec des atmosphères parfois plus suspendues, oniriques, ou à l’inverse plus explosives, habitées de fantaisie, d’humour.
La traversée de ces milieux occasionne quelques touches satiriques…
Il était important pour moi que le portrait passe par les rencontres avec de vrais personnages secondaires qui participent à sa construction. Ces portraits-dans-le-portrait sont parfois critiques mais de manière discrète. Par exemple le casting a soulevé chez moi des questions « politiques » : pourquoi devrait on choisir un comédien blanc de 50 ans pour incarner le rôle du médecin ? Il fallait que le film soit un prolongement de la vie, et dans la vie, en France, il y a des médecins noirs. C’est le cas du médecin, au début. Quant à la gynécologue, j’ai pensé à demander à Audrey Bonnet de l’interpréter après avoir admiré sa fragilité sur scène. Marie Rémond, Erika Sainte ou Léonie Simaga sont elles-mêmes dans des processus d’écriture, de réalisation, de création; les échanges avec elles étaient augmentés de ce regard-là. Nathalie Richard, immense comédienne qui a été ma tutrice à la Fémis et qui interprétait le rôle principal de Body, mon moyen métrage, joue la mère de Paula – à la réflexion, elle a eu une fonction de cette ordre dans ma formation. Cette « matière-là », ces femmes qui interagissent, enveloppe je l’espère presque totalement les aspects de critique sociale. Aussi bien ces actrices que leurs personnages refusent d’être figés, comme Paula qui, au début, critique la photo d’elle qui a fait connaître Joachim sur la scène artistique.
Quand Paula vit à l’hôtel, elle regarde à la télé « Mirage de la vie » de Douglas Sirk (1959). Est-ce une inspiration ?
C’est un moment très fort du film, entre une mère et sa fille. L’autre mère, la blonde, a beau avoir l’argent, les hommes et la gloire professionnelle, elle passe complètement à côté de la relation avec sa fille et s’en rend compte à l’enterrement de la mère noire, qui est pleurée par des dizaines d’amis. Quand j’écrivais l’histoire de Paula, je voulais laisser planer constamment le risque de se tromper, de mal tourner, de prendre le mauvais chemin et finalement de vivre une vie qu’on n’aurait pas dû avoir, une imitation de la vie, qui est le titre original du film de Sirk. Comme la mère noire du film, Paula à la fin n’a pas grand chose, mais ce qu’elle a est vrai, même si ce n’est ni glorieux ni confortable. Il y a pour moi une poignée de films qui ont directement compté pour « Jeune femme », en plus de « Sue perdue dans Manhattan », qui avait aussi marqué ma chef-opératrice : d’autres portraits forts comme « Naked » de Mike Leigh (1992) avec David Thewlis, excellent acteur dont je souhaitais trouver un équivalent féminin, « Wanda » de Barbara Loden (1970), « Une femme sous influence » de John Cassavetes (1975), ou « Claire Dolan » de Lodge Kerrigan (1998) – des personnages de femmes seules mais très dignes, qui ont constitué des repères, y compris des repères de jeu. Mais mes inspirations sont aussi littéraires : j’ai admiré Anaïs Nin, Fitzgerald, Woolf, ou Zola et sa petite vendeuse du Bonheur des Dames, plein de romans graphiques comme « Whiskey & New York » de Julia Wertz, au ton désespéré et drôle, que j’ai fait lire à Laetitia.
Pourquoi avoir choisi un titre générique, « Jeune femme » ?
Au tout début de l’écriture, j’avais imaginé que Paula avait été photographiée par Joachim avec un chapeau jaune, et le titre de la photo était « Jeune femme au chapeau jaune », comme une toile de peintre. Paula questionne cette abstraction figée, qui l’insupporte. Quand le psychiatre lui dit : « Vous êtes une jeune femme libre », l’expression la jette dans une colère violente. C’est aussi la question toute simple que je me suis posée en permanence pendant l’écriture : que signifie être une jeune femme ? On est souvent amenées à entrer dans un cadre, une identité, une définition. Jeune femme, l’expression doit rester libre, volontairement indéfinie. Paula, autant que le film, cherche sa liberté, son identité propre. Mais le titre international, c’est Montparnasse Bienvenue, qui fait honneur au quartier Montparnasse dans lequel Paula travaille, dîne avec Joachim, etc. C’est sur cette place que j’ai vécu à 18 ans en arrivant à Paris, en chambre de bonne. C’est l’ironie du « bienvenue » car Paula n’est bienvenue nulle part, et pourtant elle pousse des portes.
Entretien mené par Charlotte Garson, avril 2017