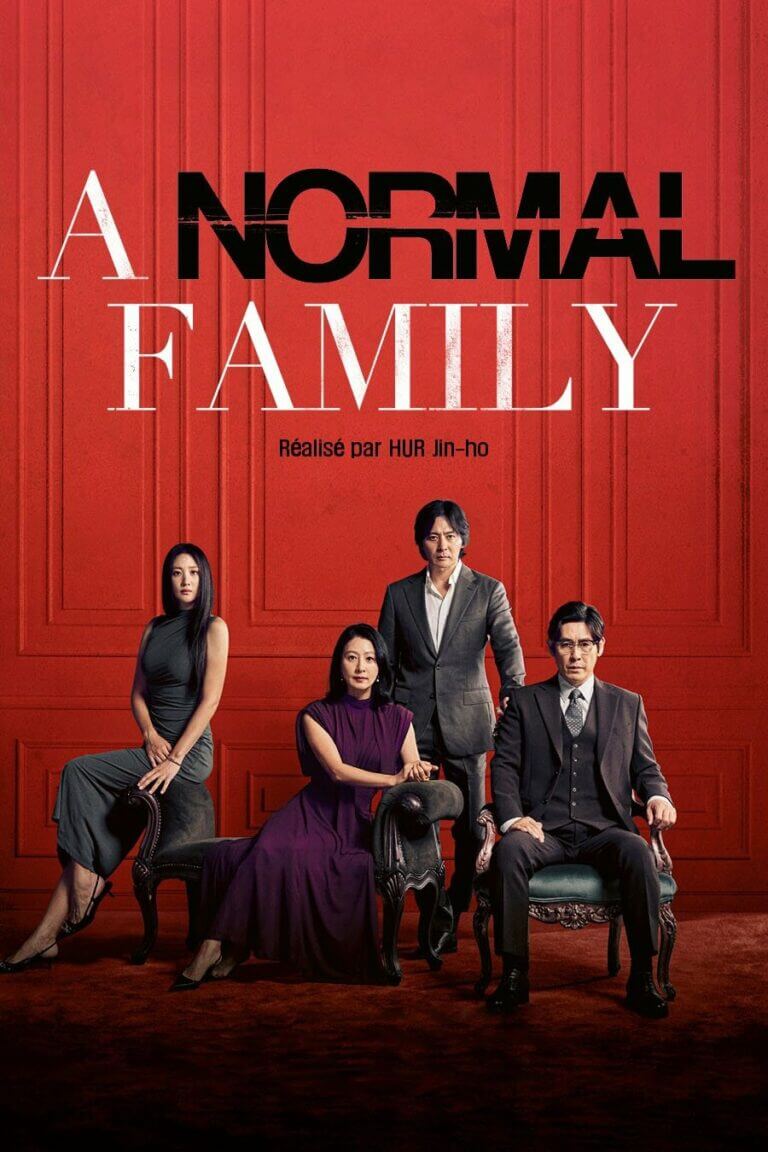Julie (en 12 chapîtres)
De Joachim Trier
Norvège / 2021/ 2H08/ VOST
Avec Renate Reinsve (Prix d’interprétation féminine Cannes 2021), Anders Danielsen Lie, Herbert Nordrum
Telerama ( Jacques Morice) : Allant et grâce poétique. Ce sont les qualités premières de cette comédie romantique, où l’on perçoit quelques accents du cinéma de Woody Allen, mais aussi une forme littéraire toute européenne. La Julie du titre est dépeinte à travers douze chapitres, comme dans un roman. Douze moments qui englobent plusieurs années de son existence, autour de la trentaine surtout. Dans un prologue ne manquant pas de saveur, on apprend que la demoiselle était dans sa jeunesse une étudiante brillante, qu’elle a fait des études de médecine puis, insatisfaite, a changé de branche, en voulant devenir psychologue. Avant de changer à nouveau pour se lancer dans la photographie, avec le soutien de sa mère, étonnée mais compréhensive. Une pointe d’ironie filtre, bien sûr, laissant deviner une Julie versatile. Une touche-à-tout qui papillonne, ne sachant pas exactement ce qu’elle veut.
C’est à la fois vrai et faux. Les facettes de Julie sont multiples. Joachim Trier fait d’elle un portrait psychologique et sentimental subtil, à travers ses activités professionnelles, ses liens de famille. À travers, surtout, deux histoires d’amour successives. La première avec Aksel, un auteur de bande dessinée reconnu, esprit libre et iconoclaste plus âgé qu’elle (le formidable Anders Danielsen Lie, révélé dans Oslo, 31 août) ; la seconde, avec Eivind, un grand gaillard doux et protecteur (Herbert Nordrum, un faux air d’Adam Driver), qui quitte pour elle sa compagne, une écologiste à la fois rigoriste et autocentrée. Le film est parfois mordant, proche de la satire sociologique. En faisant de son héroïne un possible emblème de sa génération, Joachim Trier explore aussi l’écart qui la sépare de ceux qui, comme Aksel et lui-même, n’ont pas grandi avec le numérique. Qui sont donc attachés à la culture matérialisée, mais aussi à l’idée d’un art amoral, pas facilement compatible avec le dogmatisme de certaines positions néoféministes
Toujours captivant et fluide, piquant et tendre, Julie (en 12 chapitres) bascule dans son dernier tiers, offrant soudain une partition nettement plus grave. Le film s’avère alors particulièrement poignant. Pour autant, Joachim Trier(réalisateur aussi de Oslo, 31 aout) se refuse à toute noirceur, préférant se tourner du côté d’une sagesse qui n’a rien de mièvre. Bien malin qui peut dire à la fin si le trajet de Julie aboutit à une forme d’échec. Ou à l’épanouissement discret et neuf d’un dandysme au féminin.
Première (Gael Gohlen) Ca pourrait être caricatural, lénifiant ou arrogant, répétitif. C’est au contraire drôle, lumineux et touchant. Mais pourquoi ça fonctionne ? Comment ce cinéaste qu’on associait à un art austère, dur comme le métal et froid comme l’Aquavit, finit-il par faire fondre le spectateur ? La réponse se trouve à la fin du film. Julie se conclue sur une chanson, une des plus belles mélodies du monde : la version anglaise de Agua de Março, Waters of March chantée par Art Garfunkel. Au Brésil, les « eaux de mars » annoncent la fin de l’été et le début de l’automne. Au fond, il y a du Amélie Poulain dans cette Julie, un peu d’Ally McBeal aussi, cette impertinence rieuse, ce second degré truqueur et cette poésie joyeuse de la mélancolie qui l’inscrivent à côté de ses deux aînées dans le panthéon des grandes héroïnes ciné-série. Evidemment, tout cela ne serait rien s’il n’y avait pas quelqu’un pour lui donner corps. Renate Reinsve, inconnue jusqu’ici, est phénoménale : elle apporte ce qu’il faut d’aspérité, de spontanéité et de vitalité au délire de Trie