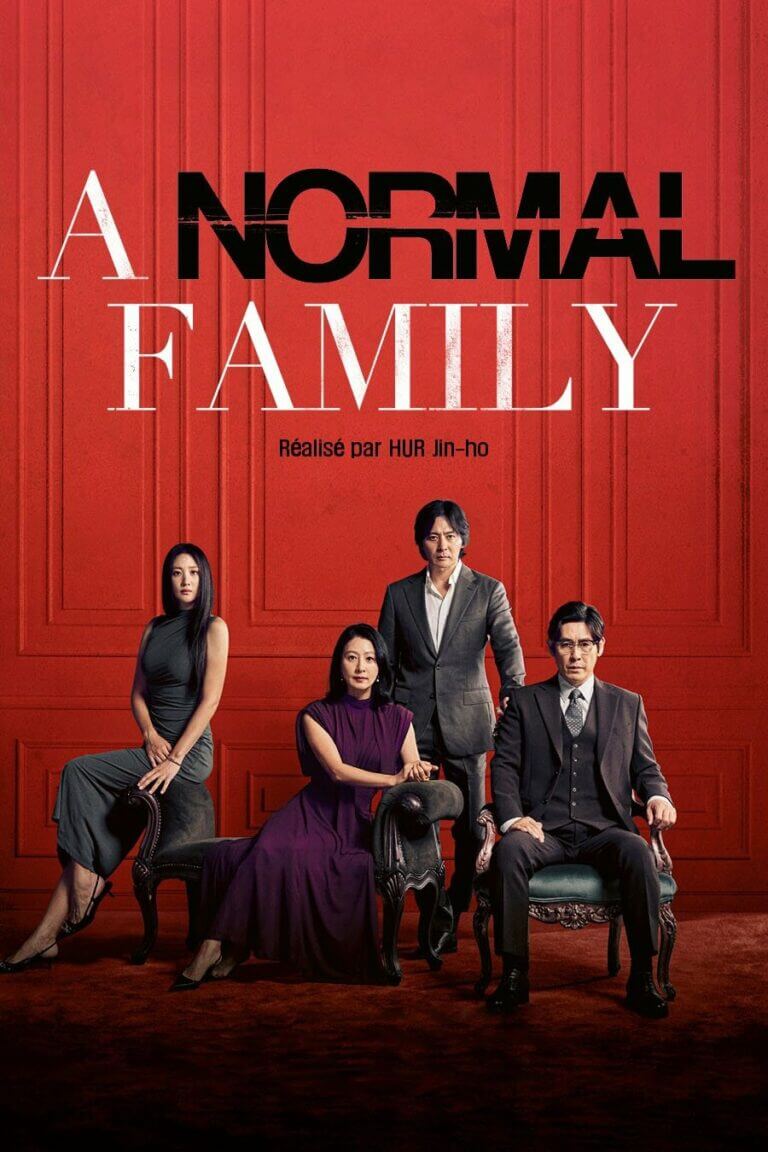Film français et israélien d’Eran Kolirin. Avec Alex Bachri, Juna Suleiman, Salim Daw, Eihab Salame (1 h 41).
Le titre du nouveau film d’Eran Kolirin Et il y eut un matin sonne comme la première phrase d’un conte. Et de la libre adaptation d’un roman éponyme de Sayed Kashua (Editions de l’Olivier, 2006) d le cinéaste tire un très beau film.
Celui-ci nous mène dans un village arabe d’Israël construit sur une colline, au milieu d’une zone désertique. Le village où Sami (Alex Bachri) est né et a grandi, avant de partir pour Jérusalem, laissant derrière lui sa famille et ses amis. Depuis, il ne leur a guère rendu visite. Mais, cette fois, il y a été contraint par le mariage de son frère cadet. Sami est revenu avec sa femme, Mira (Juna Suleiman), et son fils, Adam, le temps d’un week-end.
Quand débute le film, la fête bat son plein. On danse, on chante, la famille manifeste son bonheur d’être enfin réunie, fière et heureuse de revoir Sami, le fils aîné qui, loin d’ici, s’est fait une belle situation. Lequel se tient à l’écart, impatient de repartir, de retrouver sa vie, son milieu, la femme dont il est tombé amoureux et pour qui il est à deux doigts de tout quitter. En attendant, il traîne son ennui, constatant avec une forme de supériorité à quel point ses proches sont devenus des étrangers. Qu’importe, demain il sera chez lui Chez Kolirin surgit toujours un événement imprévu qui crée la bascule ,qui dévie la trajectoire de l’orchestre (La Visite de la fanfare), un court-circuit qui se produit dans l’esprit du héros (The Exchange, 2011) et le récit déraille. Ici, ce sera l’intervention de l’armée israélienne qui, durant la nuit, a encerclé le village. Au lever du soleil, un mur a été édifié, des soldats postés, qui interdisent aux habitants le moindre déplacement, les privent de toute communication avec l’extérieur.
Le village s’apparente désormais à une scène de théâtre sur laquelle se joue une tragi-comédie. Les personnages, assignés à résidence, y tournent en rond, occupent leur temps comme ils peuvent, s’interrogent, certains esprits s’échauffent. Le caïd du village profite du désordre pour asseoir son pouvoir. Abed (Eihab Salame), le chauffeur de taxi, continue de rouler (à vide), passant et repassant sous les fenêtres de sa femme qui l’a quitté, dans l’espoir que son nouveau véhicule rutilant, une Mercedes dernier cri, pourra séduire et faire revenir la belle. Nabil (Doraid Liddawi), le beau-frère de Sami qui siège au conseil municipal, s’acharne, quant à lui, à poursuivre les Palestiniens sans papiers, responsables selon lui de la situation. Au fur et à mesure que les jours passent, les certitudes trébuchent, les sentiments s’exacerbent, les consciences s’éveillent. Sami renoue des liens avec d’anciens copains. La vie continue, mais, pour beaucoup, opère une mue et change de trajectoire.
Observateur attentif et tendre de tous ses personnages, Eran Kolirin s’attache à saisir, au sein de ce huis clos chaotique, la moindre lueur. Tous ces instants déchirent l’obscurité, apportent leur part de poésie et de drôlerie. Comme si, au fond, le cinéaste s’évertuait à maintenir la flamme qui permettra d’éclairer le plus longtemps possible cette poignée d’hommes et de femmes qu’une situation absurde a rendus prisonniers et invisibles.