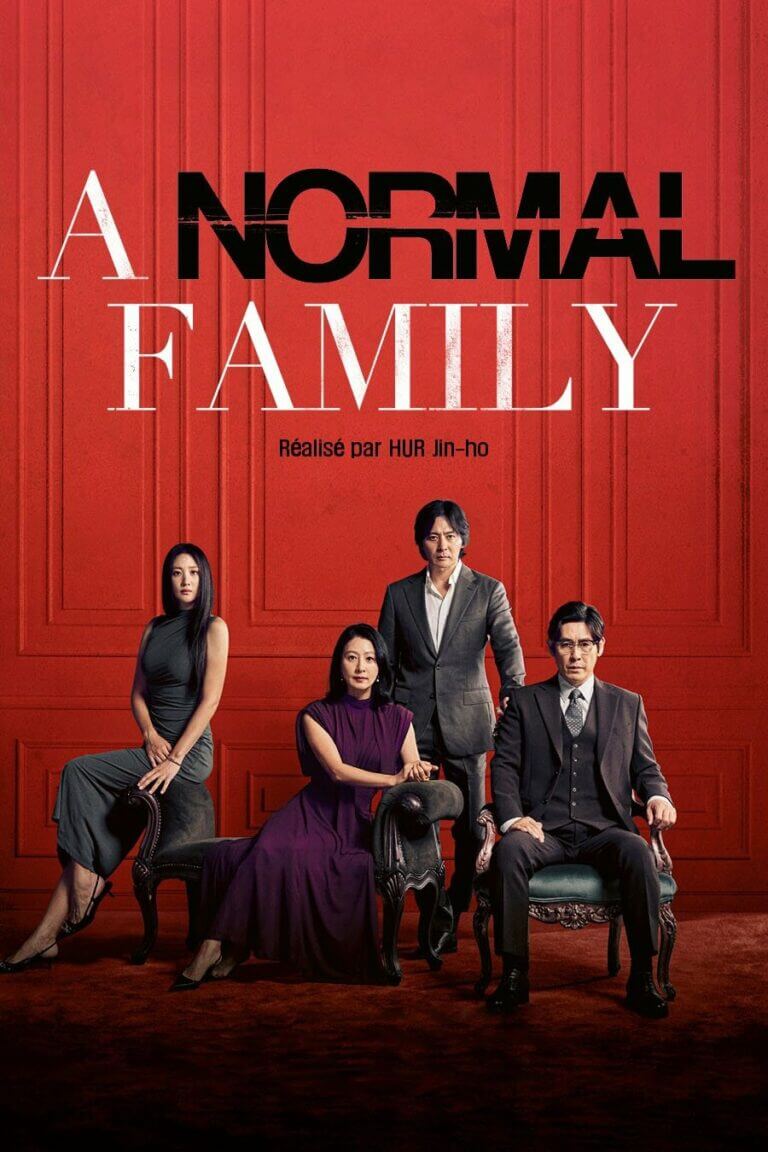Né le 16 décembre 1978 à Kanagawa
Né le 16 décembre 1978 à Kanagawa
Japon
Réalisateur, scénariste
Senses
Ryusuke Hamaguchi revient sur ce qui l’a inspiré pour «Asako» et commente les contraintes et les limites du cinéma commercial qui prévalent au Japon.
Après le réalisme de Senses, Asako surprend par ses embardées surréalistes. Pourquoi ?
Asako est mon premier film commercial, et au Japon, la différence entre films dits indépendants et films commerciaux est vraiment grande, il y a un zéro de plus ou de moins dans le budget. Cette différence s’accompagne de toutes sortes d’obligations, comme la nécessité d’être compris par un public plus large,
ou de se limiter à une durée de deux heures. Cela a été très dur pour moi de contenir ce que je voulais représenter dans cette durée, je suis un habitué des films de cinq heures. Donc mon défi était : est-ce que je peux, sur une durée si brève, arriver à élever les sentiments des personnages comme j’ai réussi à le faire dans Senses ? Cela a eu un impact sur la narration. J’ai décidé de faire quelque chose de plus rapide, où les événements surviennent de manière très soudaine, ce qui entraîne la présence de ces éléments presque magiques que vous évoquiez. Ils sont liés au personnage de Baku, qui bien sûr vit dans la réalité du film mais est complètement irréel. C’était déjà le cas dans le roman dont Asako est adapté.
Pourquoi vous être intéressé à ce roman ?
D’abord, parce qu’une femme y tombe amoureuse de deux hommes qui ont le même visage, une situation qui a trait au mythe. Cela présentait pas mal de défis, car c’est difficilement crédible de nos jours. Il fallait aussi montrer la variation de sentiments ressentis par Asako sans que cela paraisse mièvre. En lisant le roman, j’ai cru à tout, et la manière qu’a l’auteure de décrire les situations m’a beaucoup inspiré : la représentation du quotidien est très réaliste, on voit les personnages en fonction de ce qu’ils voient autour d’eux. Je me suis dit que ce serait assez facile à adapter au cinéma. L’autre élément, c’était le surgissement dans le livre de la réalité sociale du Japon. L’intrigue se déroule sur une décennie, donc en plus de cette histoire centrale de trio amoureux, le laps de temps comprenait aussi le 11 septembre, et la triple catastrophe du 11 mars 2011 au Japon.
Dans Asako comme dans Senses, l’arrière-plan social est fondamental… La scène du tremblement de terre est un des moments forts. Qu’est-ce que cette catastrophe a provoqué chez vous ?
J’étais à Tokyo le 11 mars, et même si l’on a aussi ressenti les secousses, l’intensité était plus ou moins grande selon l’endroit où l’on se trouvait, donc je ne me suis pas rendu compte qu’une chose aussi terrible était en train de se produire. Cela n’a été clair qu’en fin de journée. Mais ce qui m’a surtout marqué ce jour-là, c’est que j’ai fait une expérience très rare : j’ai parlé avec beaucoup d’inconnus. Personne ne pouvait rentrer chez soi, je suis allé dans un café, et tous ces gens qui ne se connaissaient pas ont engagé des conversations. Cela m’a marqué. L’autre manière dont la catastrophe m’a influencé, c’est bien sûr que je me suis rendu, après, dans le nord-est du Japon, au cœur de la région sinistrée, pour tourner des documentaires. J’en ai réalisé trois.
Ont-ils nourri votre cinéma ?
Ces documentaires consistaient à faire parler les sinistrés. Mais plutôt que de leur demander ce qui s’était passé, nous cherchions à savoir qui était la personne à qui tout cela était arrivé. Mon coréalisateur et moi avons donc dit à nos interlocuteurs que tout pouvait nous intéresser. Leur humanité s’est vraiment reflétée dans les interviews et cela m’a fait réfléchir. Cela rejoint un peu le thème de la performance que nous évoquions : là aussi l’accumulation d’expériences vécues par ces personnes est apparue à l’écran, ils dégageaient une force énorme. C’est là que je me suis rendu compte qu’à l’écran, la question n’est jamais de savoir si les personnages sont beaux ou laids, s’ils sont ou non des professionnels, car la caméra peut toujours capter leur beauté. Si l’on en revient au jeu des acteurs, il ne s’agit donc pas pour eux de porter un masque, mais de faire en sorte, lorsqu’ils prononcent leurs répliques, que tout ce qu’ils ont accumulé dans leur vie personnelle apparaisse. C’est cela qui donne de la force à un film. Voilà l’enseignement que j’ai reçu de la catastrophe.
Il y a quelque chose d’angoissant dans Asako, un suspense un peu étouffant…
Tous les films intéressants ont du suspense. Si l’on peut en ressentir ici, c’est parce que l’on perçoit qu’il y a un équilibre très étrange, qu’il suffirait de pousser un peu pour que tout se renverse. Comme chez Hitchcock. L’idée, c’est que le public se retrouve embarqué dans le film, que public et film ne fassent plus qu’un, comme s’il n’avait manqué qu’une chose au film : la participation du spectateur. C’est ce que je vise dans mon cinéma. Jusqu’ici, j’ai toujours fait des films sans budget, ce qui se ressent dans l’image assez pauvre, mais je me suis demandé comment enrichir cette image : il n’y avait que l’imagination des spectateurs pour le faire. Pour intégrer cette imagination au film, le suspense est nécessaire.
Il y a presque toujours des artistes au travail dans vos films. En quoi est-ce cinématographique ?
J’ai encore du mal à répondre à cette question, mais oui, cela m’attire. Je crois que cela a trait à la question du temps. Un corps qui s’est entraîné pour une performance a en quelque sorte accumulé du temps, un temps immédiatement perceptible pour les spectateurs. C’est pour cela qu’ils ne peuvent s’empêcher de regarder. La performance est irrésistible aussi pour un réalisateur, car elle donne une forme à la fiction, par essence abstraite, et elle pousse, aussi, le reste des scènes du film à être au niveau de ce qui a été représenté. Donc je me suis mis à en intégrer dans mes fictions. Après coup, je me suis rendu compte que de grands classiques de Mizoguchi ou d’Ozu contiennent des scènes de kabuki, de théâtre nô, de bunraku, représentées de manière étrangement longue. Les personnages du film ne jouent pas ces pièces mais les regardent, elles n’ont pas de rapport direct avec l’intrigue, mais, par effet d’entraînement, les spectateurs du film se mettent à regarder eux aussi.
Pensez-vous continuer dans cette voie, ou retourner vers l’économie indépendante ?
C’est une question difficile, car les contraintes liées au cinéma commercial m’ont éloigné de l’essence de mon travail. J’y réfléchis, et cela passe par une considération du travail en groupe : peut-on produire ensemble quelque chose d’intéressant dans un cadre commercial ? Ou est-ce seulement possible en étant indépendant ?
Pourquoi dites-vous que le cinéma commercial vous en a éloigné ?
D’abord par rapport au respect des acteurs. Beaucoup de gens de cinéma, à commencer par les producteurs, considèrent que les acteurs doivent juste apprendre leur texte et le réciter du début à la fin de la prise. Mais quelque chose s’est clarifié en moi avec le tournage de Senses : combien jouer représente une charge psychologique énorme. Et pas seulement parce qu’il s’agissait, dans Senses, d’acteurs non professionnels ; se mettre à nu est très lourd pour n’importe qui. Si l’on veut que la caméra capte quelque chose de l’être intime des comédiens, et pas simplement leurs prouesses techniques, il faut les placer dans des conditions optimales et attendre, s’ils ne se sentent pas prêts. Leur jeu aura un impact énorme sur le film.