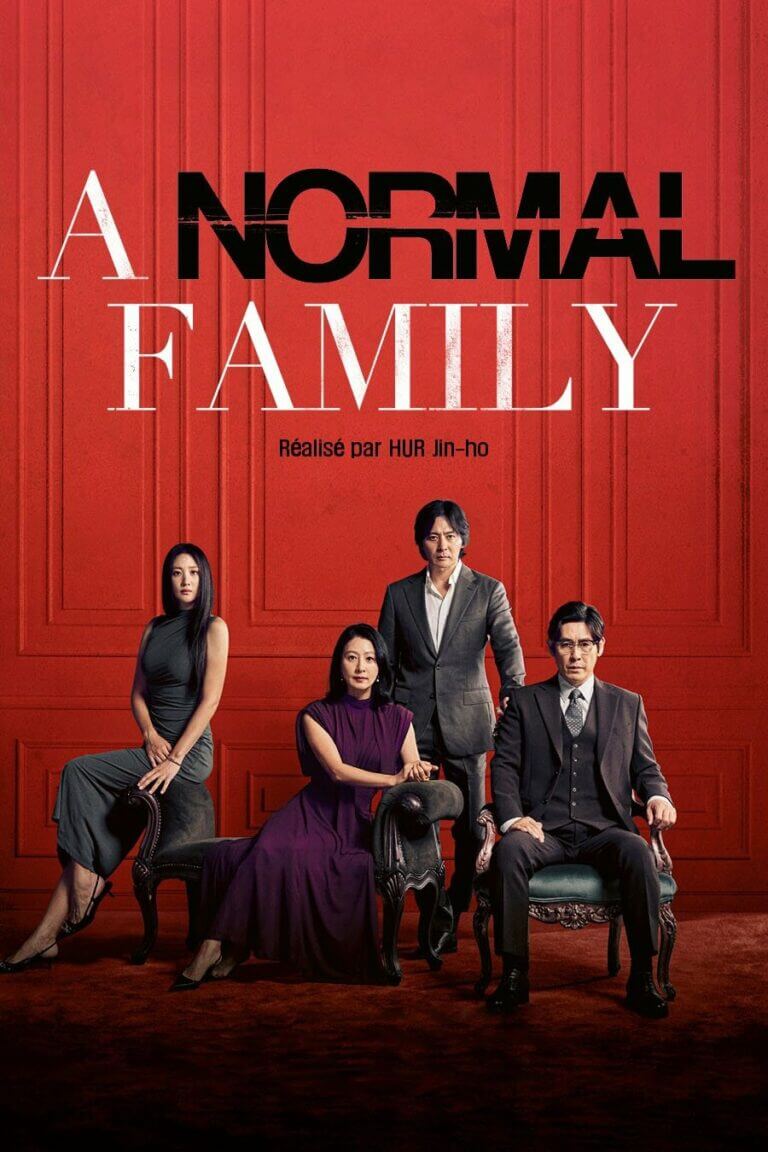Né le 23 janvier 1953 à Akron
USA
Réalisateur, scénariste, compositeur
Stranger than Paradise, Dead Man, Ghost Dog la voie du Samouraï, Coffee and Cigarettes, Broken Flowers, Only Lovers Left Alive, Paterson
Les illuminations de Jim Jarmusch
Deux films du cinéaste-poète éclairent la sélection officielle cannoise, « Paterson » et « Gimme Danger ».
Jim Jarmusch ne fume plus, mais il joue encore avec les allumettes. Il aime le son qu’elles produisent quand elles entrent en contact avec le frottoir, il apprécie la texture rugueuse et boisée de leur tige, il fantasme sur le design désuet de leur boîte.
Il en raffole tellement qu’il parsème ses films de bûchettes, comme un Poucet superstitieux : les allumettes sont ses amulettes à lui. Dans The Limits of Control (2009), une boîte siglée « Le Boxeur » circulait de main en main ; Paterson, qu’il présentait lundi 16 mai à Cannes, en compétition, s’ouvre sur un poème à la gloire de la marque « Ohio Blue Tip ».
« Mon ami Ron Padgett a écrit des vers spécifiquement pour ce film. Il m’a également autorisé à utiliser des poèmes préexistants, dont celui-ci. J’ai grandi dans l’Ohio, nous ne grillions que des allumettes Ohio Blue Tip. Ce sont les meilleures. » Jarmusch vous dit cela d’une voix cramée par la fatigue, sur une terrasse brûlée par un soleil de fin de festival ; en ce jeudi soir, Gimme Danger, son documentaire consacré aux Stooges, le groupe d’Iggy Pop, vient d’enflammer la sélection officielle, hors compétition.
En anglais, « allumette » se dit « match ». Jolie polysémie, qui renvoie, outre la transmission du feu, à des notions plus abstraites : concordance, correspondance. Celles-là mêmes qui conduisent Jarmusch à offrir à son acteur principal, Adam Driver, le rôle d’un « bus driver », et à faire coïncider le nom de ce chauffeur avec celui de la ville du New Jersey où il exerce – Paterson, donc, qui va jusqu’à donner son titre au film. L’onomastique, c’est fantastique : dans Paterson, tous les noms propres, ou presque, désignent des biens communs.
Aboyant, jappant, frétillant
« Je ne suis pas quelqu’un de très analytique, tempère l’auteur de Coffee and Cigarettes. Mais des coïncidences apparaissent çà et là, sur la planète ; j’aime les célébrer, comme un poète fait rimer certains mots ou un musicien accorde certains sons. » Mine de rien, voilà qui éclaire l’œuvre tout entière : et si, film après film, Jarmusch ne faisait rien d’autre que gratter bruits, images, acteurs, situations – en espérant que, de tous ces frottements, surgisse l’étincelle ? Plus jeune, le petit Jim se rêvait poète. « Je considérais Rimbaud et Baudelaire comme des rockstars, des chamans. A mes yeux, la même rébellion courait d’Iggy Pop à William Blake, du MC5 à Walt Whitman. J’ai déménagé à New York, pour étudier la poésie. J’y ai découvert les vers exubérants de Frank O’Hara, de Ron Padgett. Vous pouvez me tuer ou me jeter en prison, ces types-là resteront en moi. »
Avec Dead Man (1995), Paterson est le film de Jarmusch où transparaît le plus explicitement ce penchant lyrique. Mais, contrairement à l’épopée de Johnny Depp en bateau ivre, la poésie s’inscrit ici dans un quotidien éminemment prosaïque – griffonnée sur un coin de volant par le chauffeur, raturée, triturée, mâchonnée. Les films de Jarmusch se répondent comme les jeudis, vendredis ou samedis qui rythment Paterson : ils riment. Dans Gimme Danger, le chanteur de I Wanna Be Your Dog est montré aboyant, jappant, frétillant, un collier de chien autour du cou, tandis que le jeu de son guitariste, James Williamson, est comparé à un « clebs renifleur de drogue ». Mêmes qualités canines dans Paterson : l’humour doit beaucoup à la performance de Marvin, un bouledogue bipolaire, dont Jarmusch vante « l’humilité et la réactivité ».
Un chien et ses maîtres, un chanteur et son groupe : les deux films racontent cette complicité qui aide les êtres à traverser la vie, si simple quand tout roule, si prompte pourtant à déraper. Plusieurs fois, dans son film comme dans la conversation, Jarmusch appelle Iggy Pop « Jim », diminutif du vrai nom du chanteur, James Osterberg. De fait, Gimme Danger peut se voir comme un autoportrait en creux. En ce rockeur élevé dans une caravane, au beau milieu d’un Midwest grisâtre et industrieux, le cinéaste s’est trouvé plus qu’un ami – un compagnon de route, et de fortune. A un moment donné, Iggy, dont c’est la troisième apparition dans un film de Jarmusch, admet sa dette à l’égard d’une émission de télévision qu’il regardait enfant, « Soupy Sales ». L’animateur y contraignait ses jeunes invités à s’exprimer en « vingt-cinq mots ou moins » : « De là vient mon style d’écriture – droit au but », minimalise l’animal Pop dans le docu, d’une parole aussi grave, lente et resserrée que celle de son portraitiste.
« Rage chevillée au corps »
Jarmusch avait tourné son précédent film, Only Lovers Left Alive (2013), entre Tanger et Detroit, où ont rampé les Stooges. Paterson combine le passé poétique de l’une et l’histoire industrielle de l’autre : « Cette ville est un microcosme de l’Amérique, estime le cinéaste aux aïeux tchèques, irlandais et allemands. Les premières manufactures de textile du pays y ont vu le jour, à cause de ses cascades. Elles ont attiré des générations d’immigrés, d’abord irlandais ou italiens, puis des Noirs, des Sud-Américains, beaucoup d’arabophones aussi – si bien que Donald Trump a prétendu que des milliers de musulmans y auraient célébré les attaques du 11-Septembre, ce qui est faux, bien sûr. Paterson a marqué l’histoire de l’anarchisme, du syndicalisme. Ainsi, étrangement, que celle de la poésie : Ginsberg y a vécu, William Carlos Williams, l’un de mes poètes préférés, lui a consacré un livre – c’est par lui que j’ai découvert cette ville, il y a vingt-cinq ans. Il était médecin ; parmi ses patients figurait Robert Smithson, autre artiste que je révère. »
Tom Waits disait de Jarmusch qu’il puisait son sentiment d’étrangeté dans ses cheveux, qui ont blanchi dès l’âge de 15 ans. Deux ans plus tard, à 17 ans, à quelques miles de chez lui, quatre jeunes manifestants étaient tués par la police, à l’université de Kent State. Neil Young, à qui il consacrerait son premier documentaire musical, en 1997, en tira une chanson fameuse ; de cette fusillade, Jarmusch gardera « une rage chevillée au corps, à vie ».
Lunettes satinées sur crinière platinée, l’ex-indie kid partage son temps entre New York et les Catskill Mountains, où il goûte, à 63 ans révolus, la compagnie des ours, des biches et des mouffettes. Il cite William Carlos Williams : « No idea but in things » – toute idée vient des choses. Un pragmatisme qui le fait se réjouir d’être désormais distribué et coproduit par Amazon, et de tourner en numérique depuis 2013 : « En dosant les filtres de densité neutre, en désaturant les couleurs, en violaçant certains noirs, on obtient des résultats satisfaisants. »
Sur son visage passe une lueur enfantine. Une heure auparavant, il montait les marches avec Iggy. Synchrones, les deux compères dressaient leurs majeurs en direction des flashs des photographes, comme autant de tiges incandescentes. Allumeurs allumés ? Bientôt, les gazettes titreraient, en lettres de feu : « Jim Jarmusch et Iggy Pop embrasent le Festival. » Il en va ainsi des allumettes : petits brins, gros effets.
Aureliano Tonet Journaliste au Monde