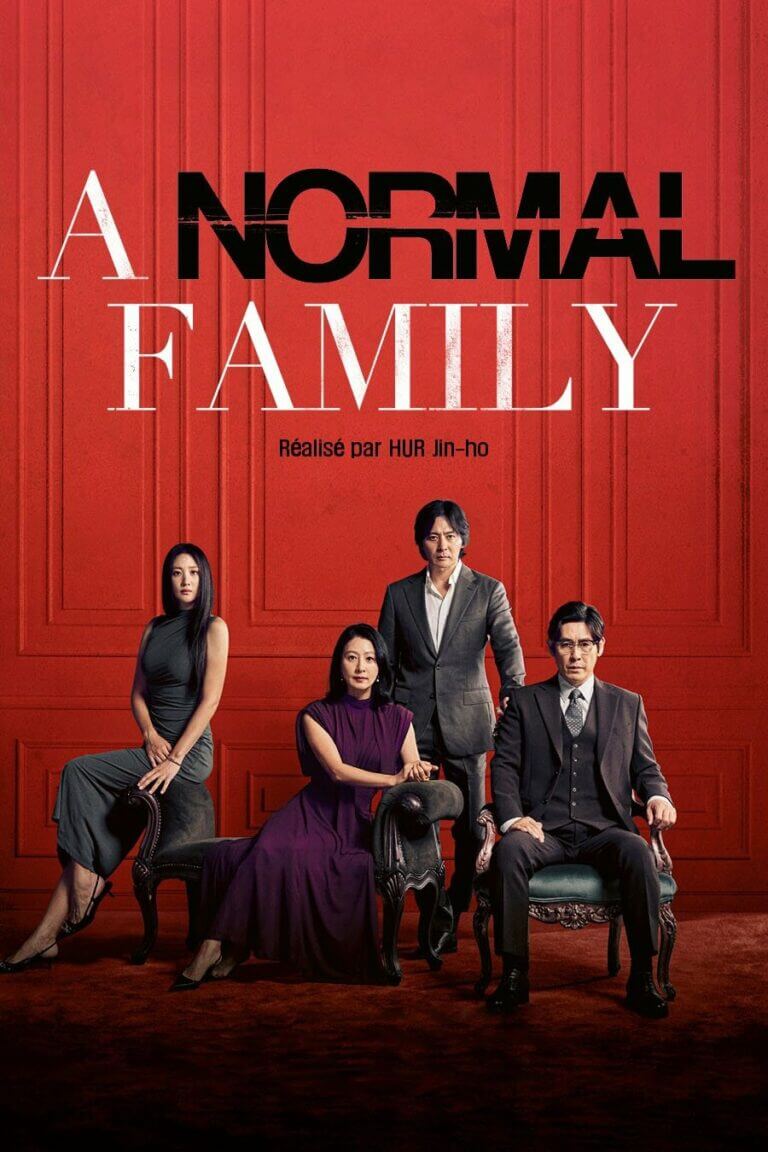Du 4 au 9 février
 De Todd Haynes – GB/USA – 2015 – 1 h 58 – VOST
De Todd Haynes – GB/USA – 2015 – 1 h 58 – VOST
Avec Cate Blanchett, Rooney Mara, Kyle Chandler…
Carol est une femme en train de s’écrouler, elle ne tient plus que par l’artifice de son statut d’épouse et de mère, belle et mondaine. Thérèse est une jeune femme légère et insouciante, en train d’éclore, que la société des années cinquante pousse à se couler dans le moule que l’époque choisit pour elle : être une gentille épouse et une mère modèle. Quand elle croise le regard un peu froid de cette femme distinguée à la silhouette parfaite, Thérèse est subjuguée. Lorsque Carol croise le regard de cette petite vendeuse de jouets à l’allure encore juvénile, elle est fascinée par cette candeur, pas encore broyée par le poids des convenances; c’est un appel au rêve pour elle, depuis trop longtemps prisonnière d’un mariage raté.
Magistralement filmées, les deux comédiennes forment un duo troublant de sensualité et de douceur contenues. Un film somptueux.
Prix d’interprétation féminine au festival de Cannes 2015 pour Rooney Mara
Critique
Après avoir embaumé avec faste le cinéma de Douglas Sirk dans Loin du Paradis, Todd Haynes a opéré, avec I’m Not There, un retour vers l’autre versant de sa filmographie, le faux biopic. Au tombeau d’un maître, succédait ainsi la déconstruction d’une icône culturelle (Bob Dylan) en autant de numéros d’acteurs, à commencer par Cate Blanchett, dont le transformisme radical battait Christian Bale et Heath Ledger à leurs propres jeux. Les retrouvailles, huit ans plus tard, de la star australienne et du réalisateur californien dans un mélodrame plantant à nouveau sa tente dans l’Amérique corsetée des années 50 pouvaient laisser perplexe. Doutes dissipés à la découverte de Carol, qui se hisse sans mal à la cimaise d’une œuvre protéiforme et parfois excessivement maniérée, mais que la mini-série télévisée Mildred Pierce avait, il y a cinq ans déjà, mise sur la voie du néoclassicisme.
Imitation of Life
À vouloir dupliquer l’univers en Technicolor de Sirk, Loin du paradis n’en cherchait pas moins à révéler au grand jour le refoulé homosexuel de la figure de Rock Hudson, dont le succès reste indissociable de celui du cinéaste allemand exilé à Hollywood. À la littéralité du geste, se mêlait donc une part d’ironie, qu’atténuait l’interprétation, désarmante de sincérité, de Julianne Moore en épouse dévouée surprenant son mari avec un homme. Ce révisionnisme produisait l’effet d’une greffe expérimentale dont la réussite formelle s’accompagnait d’un souci constant d’ausculter le passé pour y diagnostiquer les maux du présent. À cette critique sociale qui se réclamait aussi de l’héritage politique d’un Fassbinder, Carol substitue un programme aussi modeste que concluant : chercher le cœur battant de ses deux personnages, qui n’en formeront plus qu’un le temps d’une étreinte.
Haynes est aidé dans sa quête par un scénario mûri pendant presque 15 ans par Phyllis Nagy, qui n’a retenu du livre de Patricia Highsmith dont il est adapté que l’essentiel : l’histoire d’une passion interdite, racontée à la manière d’un roman policier, du point de vue de l’une des deux « coupables ». En s’en remettant à la subjectivité de la plus jeune, Therese (Rooney Mara), qui remonte à la source de son désir comme on mène une enquête, le film fait de Carol tout à la fois une figure tutélaire, une obsession amoureuse et une femme fatale qui se dérobe à l’emprise du regard. Ce regard, la photographie en est le vecteur, grâce à un appareil qu’offre Carol à Therese pour encourager sa passion naissante, et dont celle-ci use dans un premier temps pour fixer la présence de l’être aimé (autrement dit pour en conjurer l’évanescence). Ces clichés sont autant de preuves qu’elle rassemble, mue peut-être par le pressentiment d’un départ imminent, qu’une intimité encore balbutiante ne parvient pas à chasser.
Cette disparition se produira lorsque Carol, en instance de divorce, est sommée de choisir entre la poursuite d’une liaison scandaleuse avec cette vendeuse de jouets de vingt ans sa cadette et la garde de son enfant. Haynes crève alors cette bulle fantasmatique dans laquelle une Therese transie maintenait Carol et révèle sa triviale existence de grande bourgeoise esseulée et malmenée par le puritanisme ambiant. Tandis que Loin du paradis se soumettait encore aux lois du genre mélodramatique en congédiant chez elle Julianne Moore sous un torrent de violons, la rupture au contraire s’avère pour Therese émancipatrice : elle devient photographe au New York Times, où elle fait l’apprentissage de son indépendance après celui de son désir. L’enivrante liberté d’être fidèle à soi-même ne se gagne pas seulement en fuyant un monde hostile à sa différence. De fait, la brèche ouverte par un road movie à mi-chemin du film n’empêchera nullement Carol et Therese d’être rattrapées par la suspicion de leurs contemporains. À leur retour, l’une et l’autre devront chercher, seules mais avec ténacité, la lumière dans une ville qui n’aura eu de cesse de les enténébrer.
Anges déchus
La recréation du New York désenchanté de 1952 est à cet égard saisissante. À l’optimisme à marche forcée des années Eisenhower, qui s’apprêtent à débuter, Haynes et son chef opérateur Edward Lachman opposent un espace urbain en forme de huis-clos. Les tonalités désaturées de la palette chromatique et l’image granuleuse du Super 16 mm projettent sur les deux amantes l’ombre du film noir sans que rien de la séduction et du mystère associés au genre n’en subsiste à l’écran. Les surcadrages accentuent la claustrophobie diffuse qui sourd d’intérieurs faits de passages, d’embrasures et d’enfilades de pièces semblables à de tristes dédales. Ce formalisme trouvera sa justification ultime dans le tressaillement d’un plan final, bouleversant, auquel le cinéaste nous aura minutieusement préparés : une épiphanie qui advient au beau milieu d’un restaurant, par la grâce d’une caméra subjective aux élans de transport amoureux.
Pour y croire, il fallait aussi deux interprètes à la hauteur d’un tel sentiment. Avec ses yeux fixes de poupée tout droit sortie du grand magasin où elle officie au début du récit et ses joues rosies par l’hiver new-yorkais, Rooney Mara est absolument parfaite, toute entière retranchée dans un mutisme prédateur. Ce visage encore marmoréen se veinera bientôt d’émotions qui culmineront dans une très belle scène charnelle. Mais seule une actrice d’une plasticité hors-norme pouvait faire miroiter les multiples facettes de Carol. Cate Blanchett lui prête son prodigieux talent, tout en modulant sa virtuosité proverbiale, et c’est un bonheur de la voir se risquer ainsi à la vérité de son personnage plutôt que de se livrer à une simple performance. L’alchimie de leur rencontre naît de frôlements et de regards, transactions érotiques reconduites de champ en contrechamp et dont la sensualité réchauffe chaque plan d’un feu qui brûle longtemps après la fin du générique. « No other love can warm my heart/Now that I’ve known the comfort of your arms », chante Jo Stafford dans l’un des standards retenus pour la bande originale. Entêtant refrain qui pourrait leur tenir lieu de viatique.
Damien Bonelli – Critikat